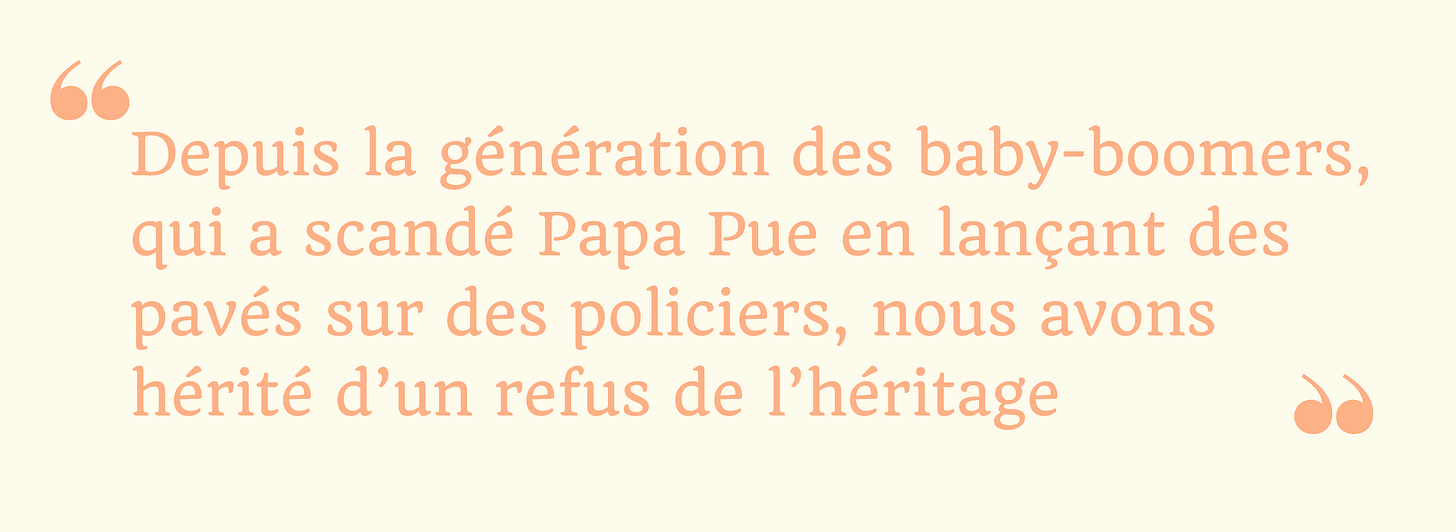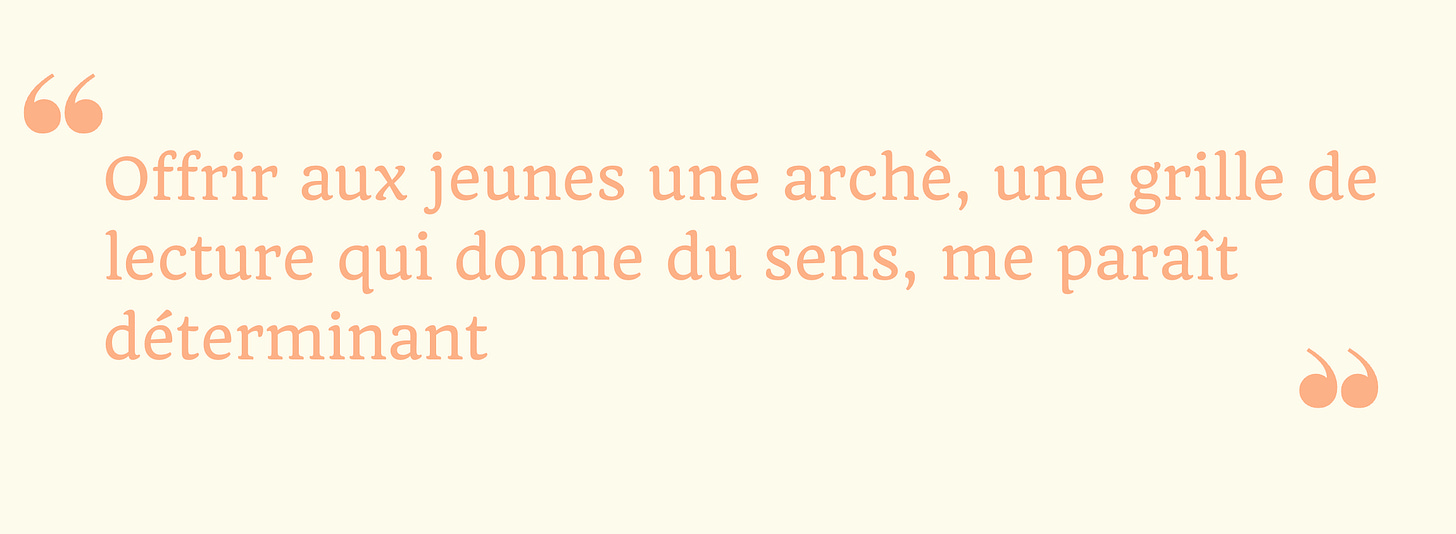Pierre Valentin : « Chaque génération rejoue la même comédie stérile d’une "annulation" de la précédente ».
Entretien avec Pierre Valentin.
Diplômé en philosophie et en sciences politiques, Pierre Valentin est un spécialiste de l’idéologie "woke". Récemment, il a lancé le podcast Transmission, disponible sur YouTube, avec un double objectif : inciter sa génération - la Gen Z (1995-2013) - à lire les œuvres classiques, et favoriser l'émergence de nouvelles figures intellectuelles.
La chaîne Transmission met les intellectuels à l’honneur et redonne au dialogue ses lettres de noblesse. Pierre Valentin prend soin de lire les travaux des invités qu’il reçoit et débute son émission par la lecture d’un extrait choisi de leurs écrits. Il privilégie ensuite la spontanéité, délaissant ses notes pour laisser place à une conversation libre, où l’écoute mutuelle et la curiosité intellectuelle prédominent.
Dans cet entretien accordé à La Lanterne, Pierre Valentin revient sur les motivations qui l’ont conduit à créer Transmission et livre son analyse des enjeux majeurs auxquels sa génération est confrontée.
LA LANTERNE : Vous avez déclaré avoir créé la chaîne "Transmission" dans le but de favoriser le dialogue entre les générations : selon vous, quels sont les principaux obstacles à ce dialogue intergénérationnel ?
Transmission a deux objectifs, en dehors du plaisir de la conversation. Premièrement, encourager ma génération à lire nos grands penseurs contemporains (et à lire tout court !). Deuxièmement, en invitant régulièrement des personnalités de moins de quarante ans, tenter de faire émerger une nouvelle génération d'intellectuels, capables de prendre la relève.
Depuis la génération des baby-boomers, qui a scandé Papa Pue en lançant des pavés sur des policiers, nous avons hérité d’un refus de l’héritage. Chaque génération rejoue la même comédie stérile d’une « annulation » de la précédente. C’est pourquoi j’écris dans mon livre qu’il n’y a rien de plus boomer que de dire « Ok Boomer ».
Pour sortir de cette stérilité héréditaire, il faut retrouver une forme d’humilité générationnelle, où les plus jeunes cherchent à apprendre des plus anciens, à condition que ces derniers acceptent ce rôle plutôt que de persister dans l’ingratitude arrogante qui caractérise souvent la génération du baby-boom.
Avec Marcel Gauchet, lors du premier épisode diffusé en juillet dernier, je crois que nous avons trouvé la recette du dialogue intergénérationnel : chacun critiquait les travers de sa génération avec enthousiasme ! Tout en étant réellement à l’écoute de ce que l’autre avait à dire.
LA LANTERNE : Dans un entretien accordé au Figaro, vous avez justifié le choix du titre "Transmission" en affirmant que « pour conserver, il faut transmettre, et pour transmettre, il faut conserver ». Les jeunes générations ne manifestent-elles pas, justement, une certaine hostilité envers le conservatisme ?
Cela dépend de la manière dont on l’entend. Le terme « conservatisme » est souvent mal compris, car on l’associe à « immobilisme », alors même que la loi de Newton sur l’entropie montre à quel point ne rien changer est la pire façon de conserver quoi que ce soit. Ceux qui travaillent dans le patrimoine le savent : un château est toujours en train de s’effondrer ! L’inaction satisfaite, c’est la mort. C’est aussi l’un des nombreux intérêts de ce terme : la transmission est, par nature, une dynamique.
Il est évident que sur le plan du constructivisme sexuel, nous ne nous dirigeons pas vers un monde particulièrement conservateur. Les repères ont été méthodiquement effacés. En même temps, comme l’a fait remarquer la journaliste et essayiste Eugénie Bastié sur la chaîne, il semble qu’il y ait également une demande de limites et de tempérance, même sur le plan sexuel, bien que cette demande s’exprime dans le seul langage disponible pour cette génération, celui du progressisme. La jeune fille qui souhaite ne pas être importunée ne se dira plus chaste, mais « asexuelle ». De même, les excès puritains du mouvement MeToo ne font que répondre aux excès libertaires de Mai 68.
Je pense que le défi majeur est de dissiper, dans l’esprit de ma génération, l’illusion de la liberté « négative », selon laquelle moins j’ai de contraintes, plus je serais libre. On croit que la liberté devrait être comme nos forfaits téléphoniques, « garantis 100% sans engagement ! ». Il y a une volonté délibérée de se déresponsabiliser. En réalité, la liberté concrète rime avec l’engagement et la responsabilité, qui sont pourtant, objectivement, autant de contraintes. La jeunesse réclame de l’ordre, du sens et une raison de vivre, mais veut en même temps continuer à vivre sans contraintes ni responsabilités. Il va falloir choisir ! Ce thème est progressivement devenu un fil rouge de la chaîne, au fil des invités et des conversations .
LA LANTERNE : Vous êtes l’auteur de l’ouvrage Comprendre la révolution woke, publié en 2023 chez Gallimard. Pensez-vous que donner la parole aux intellectuels constitue un moyen efficace pour contrer l'entreprise de déconstruction promue par le wokisme ?
La thèse de cet ouvrage est, en s’appuyant sur l’analyse d’Orwell dans La Ferme des animaux, que le wokisme est une pure négation, ce qui le condamne à tourner en rond, à effectuer une « révolution » au sens géométrique : revenir au point de départ.
Je cite un collaborateur du New York Times qui parle du « virus de la blanchité », qui « ne mourra pas tant qu’il restera des corps à infecter », ou encore nos féministes françaises woke, qui font de « l’éradication » des hommes un objectif premier et de la « misandrie » un mouvement revendiqué comme tel. Ces militants assument vouloir dupliquer ce qu’ils déplorent, la haine d’une catégorie identitaire, mais « à l’envers », par souci « d’égalité » ou de « rééquilibrage ». Il va sans dire que dans cette utopie, certains y seront manifestement plus égaux que d’autres.
Face à cette idéologie, il est nettement préférable de prévenir que de guérir. En d’autres termes, la « déradicalisation » est extraordinairement difficile. Il faut donc que ceux à qui ces théories s’adressent ne soient pas prédisposés à les trouver séduisantes. Quelles sont ces prédispositions ? L’inculture, qui mène au narcissisme, la culpabilité et le ressentiment, qui cherche à désigner un bouc émissaire pour expliquer son malheur.
Dans Transmission, des intellectuels jeunes et moins jeunes se succèdent et nous guérissent de ces déficiences. L’inculture recule devant leur érudition, la culpabilité héréditaire cède face à la fierté retrouvée dans notre grande tradition intellectuelle, et le ressentiment — que Nietzsche définissait comme « quelqu’un, quelque part, doit être responsable de mon mal-être » — se transforme en « ce quelqu’un, quelque part, c’est toi, car toi et toi seul es responsable de ton mal-être ». L’individu contemporain saisit chaque occasion de se déresponsabiliser, sans comprendre que cela revient nécessairement à abdiquer son libre arbitre, et donc sa capacité à améliorer son sort.
LA LANTERNE : Les entretiens diffusés sur votre chaîne se concluent par les recommandations de lecture de vos invités. Quels ouvrages recommanderiez-vous particulièrement, en ce qui vous concerne ?
En philosophie, Après la vertu d’Alasdair MacIntyre a été pour moi un véritablement bouleversement intellectuel. Un ami m’a dit qu’il valait la peine de le relire une fois par an pour maintenir une « hygiène intellectuelle ». Ce livre offre une grille de lecture claire, expliquant les tergiversations des philosophes modernes, où chacun critique son prédécesseur tout en tentant de résoudre ses problèmes théoriques. Offrir aux jeunes une archè, une grille de lecture qui donne du sens, me paraît déterminant, et l’essor du complotisme me semble être une conséquence malheureuse de cette absence.
Je recommande également chaudement l’œuvre de Christopher Lasch, à qui je dois énormément. J’ai dû lire La culture du narcissisme (1979) une dizaine de fois, en comprenant à chaque lecture 5 % de plus que la précédente. Toutefois, il est sans doute préférable de commencer par la fin de son œuvre, La révolte des élites (1994), qui est plus accessible. Ce livre, souvent mentionné dans l’espace public mais rarement lu, parvient à aborder à la fois la politique, la sociologie, la métaphysique, la psychologie et la philosophie. Comme souvent avec Lasch, on se surprend régulièrement à vérifier la date de publication de ce qu’on lit, tant ses analyses semblent contemporaines. Quand je pense à sa carrière intellectuelle, je ne peux m’empêcher de regretter qu’il soit mort à 61 ans, d’autant plus que ses meilleurs ouvrages sont parus vers la fin de sa vie. Faisons un calcul : s’il avait pu vivre 15 ou 20 ans de plus sans sa maladie, et en publiant à une cadence moyenne d’un livre tous les trois ans, il aurait pu écrire cinq, six, voire sept chefs-d'œuvre supplémentaires ! Quelle compréhension potentielle de nos sociétés libérales avons-nous perdue…
Enfin, je voudrais transmettre un conseil de lecture plus général, donné par le philosophe Rémi Brague : « Nourrissez-vous de gelée royale ». Notre temps ici est limité, donc lisez davantage de classiques intemporels que d’essais ou de romans à la mode. Il est difficile de concevoir un choix qui se regrettera moins dans la durée !
Entretien réalisé par La Lanterne